Le mystère des orchidées albinos
Aux oreilles des non-botanistes, le mot « orchidée » évoque souvent d’exotiques créatures aux mœurs exubérantes, une image relayée par les innombrables Phalaenopsis et autres Cymbidium vendues par les fleuristes. Pourtant, avec plus de 120 espèces, cette famille se rencontre facilement sur le territoire métropolitain. Beaucoup moins commun en revanche, certaines de ces orchidées dévoilent en de rares occasions un aspect étonnant de leur personnalité aux promeneurs chanceux. Une curiosité unique dans le monde végétal que le Saule vous invite à découvrir…
Prenons la Céphalanthère de Damas (Cephalanthera damasonium) ci-dessus, une orchidée de sous-bois qui ressemble à n’importe quelle plante. Sauf que, de temps en temps, émergent dans une population des individus pour le moins excentriques !
Immaculé des pieds à la tête, on a ici affaire à un véritable albinos. Basta chlorophylla, le pigment officiel des prairies, forêts et autres écosystèmes à l’abondante verdure est étrangement absent… Le résultat est chez notre Céphalanthère, cet aspect fantomatique lui donnant l’air d’un esprit des bois (et ce n’est pas Montesquieu qui dirait le contraire). Chez d’autres espèces en revanche, l’absence de chlorophylle laisse le champ libre à d’autres pigments, notamment des anthocyanes, qui n’en attendent pas moins pour exprimer leur propre sensibilité chromatique. Le terme « albinos » n’est alors plus vraiment approprié. Voyez plutôt.

Epipactis helleborine verte (à droite) et blanche. Les anthocyanes donnent à la tige cette couleur violet peu ordinaire.
Ces histoires de pigments ne sont pas sans rappeler ce qui se passe à l’automne dans les feuilles des arbres !
Tout cela est certes fort joli, mais, n’y a-t-il pas quelque chose qui vous chiffonne ? Sans chlorophylle, pas de photosynthèse, donc rien à se mettre sous la dent. En dehors de ces orchidées particulières, une mutation touchant à la synthèse de la chlorophylle est immédiatement létale, la plante étant incapable de se nourrir. Il y en a bien certaines comme les orobanches ou les cuscutes qui sont naturellement dépourvues de l’illustre pigment vert (ça ne vous rappelle rien ?), mais c’est le résultat d’un long processus évolutif, d’une spécialisation poussée vers un mode de vie parasite. Ici, nos orchidées sont vertes dans l’immense majorité des cas, faire de la photosynthèse constitue donc leur pain quotidien, et pourtant, lorsqu’il leur manque un maillon essentiel de cette réaction complexe, elle survivent et parviennent même à fleurir et à produire des graines. Alors ? Quel secret se cache derrière leur blancheur ?
La réponse va venir d’une autre orchidée de nos forêts : la Néottie nid d’oiseau (Neottia nidus-avis).
Comme les plantes parasites que nous évoquions, la Néottie est naturellement dépourvue de chlorophylle, on s’attendrait donc à retrouver chez cette orchidée un mode de vie similaire où la plante colonise les tissus des voisines pour en détourner la sève et ses précieux sucres. Sauf que, rien de tout cela chez la Néottie, ses racines charnues forment un entrelacs compact (lui ayant donné son nom) et ne vont pas s’immiscer dans l’intimité d’autrui. C’est même plutôt l’inverse ! Quand on y regarde de plus près (au microscope par exemple), on peut voir que les cellules des racines de la Néottie sont abondamment colonisées par des filaments de champignons. Il s’agit d’une association que l’on retrouve chez la grande majorité des plantes terrestres et que l’on appelle « mycorhize » (de myco : champignon et rhiza : racine). Le fonctionnement classique d’une mycorhize est le suivant : le champignon explore un grand volume de sol grâce à son mycélium (l’ensemble des filaments) et fournit à la plante de l’eau et des sels minéraux, la plante utilise ces ressources lors de la photosynthèse et le champignon récupère une partie des sucres ainsi produits. Un deal gagnant-gagnant en somme. Pourtant, nous l’avons vu, la Néottie ne s’embarrasse pas avec ces histoires de photosynthèse et ce n’est clairement pas chez elle que les champignons vont trouver pitance. Mieux vaut pour eux aller sonner chez des partenaires plus arrangeants, les arbres par exemple. Avec eux, pas de lézard, leur feuillage est une véritable usine à sucre, très gourmande en eau et en nutriments. Les champignons sont donc non seulement bienvenus, mais indispensables pour répondre à une telle demande, en témoignent la profusion de mycorhizes que l’on peut observer sur les racines des arbres.

Ces jeunes fructifications d’amanite tue-mouches (Amanita muscaria), un champignon mycorhizien, se développent grâce aux sucres issues des arbres voisins.
Récapitulons, les arbres produisent des sucres par photosynthèse et en fournissent une partie à leurs partenaires souterrains : les champignons mycorhiziens. La Néottie forme elle aussi des mycorhizes avec ces mêmes champignons et récupère à son tour des sucres qu’elle utilise pour se développer. Est-ce que les champignons reçoivent quelque chose en échange ? Pour l’instant rien ne semble l’indiquer, mais la question est loin d’être tranchée !
Avec tout ça, le secret de nos orchidées mutantes est levé. Les albinos et autres raretés sans chlorophylle se nourrissent exactement comme la Néottie, elles extorquent sans concessions (en apparence du moins) leurs moyens de subsistance à de pauvres hères fongiques habitués à des voisins plus urbains. Et les individus « normaux », sous leurs airs d’honnêtes chlorobiontes, ne sont pas en reste ! Eux aussi prennent part à cet obscur racket. En effet, la plupart des orchidées chez lesquelles on retrouve des individus achlorophylliens sont des espèces de sous-bois où la luminosité est très faible et la photosynthèse peu efficace (plus sur les plantes de sous-bois). Elles compensent donc naturellement cette faible productivité grâce aux sucres qu’elles obtiennent de leurs champignons mycorhiziens, une stratégie mixte en quelque sorte, et un bel exemple d’adaptation à un milieu où la lumière est le principal facteur limitant.

Epipactis purpurata lorgnant goulûment sur la chanterelle à ses pieds. Même si cette plante fait toujours un peu de photosynthèse, elle complémente ses besoins en sucres grâce aux champignons alentours. Crédit photo : Henri Mathé
En guise de conclusion, les champignons mycorhiziens, en s’associant à plusieurs partenaires, sont à l’origine d’un véritable réseau d’interactions. Bien que la majorité des organismes impliqués dans ce réseau soit dans la réciprocité (ils échangent une ressource contre une autre), certains aigrefins profitent de l’aubaine pour se livrer à quelques détournements de fonds. C’est le cas de nos orchidées ayant perdu leur capacité photosynthétique au gré de l’évolution (chez la Néottie) ou suite à un rare accident génétique (chez les Épipactis et les Céphalanthères « albinos »). Mais n’allez pas croire que les champignons sont condamnés à être les dindons chitineux de la farce, nombre d’entre eux peuvent aussi dans certains cas profiter du réseau mycorhizien sans pour autant en supporter les coûts. Comme souvent, ces relations à bénéfices réciproques sont instables et dynamiques. L’émergence de « tricheurs » qui en tirent parti sans payer le coût de la collaboration est quasiment inévitable car la survie et les capacités reproductrices de ces derniers sont alors meilleures. Néanmoins, trop de tricheurs et le système s’effondre… Des mécanismes limitant leur prolifération ont par conséquent accompagné l’évolution des réseaux mutualistes que l’on observe aujourd’hui et permis leur stabilité sur le long terme. Mais là il nous faudrait un autre article !
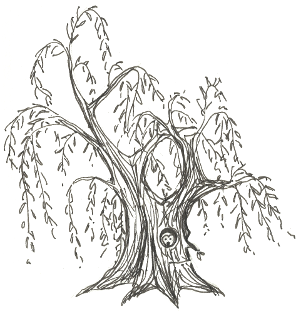





J’adore contempler les fleurs de sous-bois…et grâce à cet article passionnant, j’en sais un peu plus sur elles. Merci!
Très instructif et bien agréable à lire.
Vivement la suite…
Amitiés d’Henri
Absolument passionnant, vivement la suite !
Félicitation à l’auteur !
Un article passionnant et complet qui a su transmettre avec facilité les récentes découvertes de ce vaste monde, que constitue ces réseaux mycorhiziens !!
Merci pour cet article très intéressant. Vivement les compléments sur l’évolution du mutualisme …
Le tout avec bel humour pi(g)menté !
Très chouette !
Merci.
Tres intéressant et trop rare ce genre de discussion sur les Orchidées.
Sur les photos illustrant l’article, une reflexion me vient
Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine, Epipactis atrorubens possedent des feuilles…
– a quoi peuvent elles bien servir .
on voit que Neottie nidus-avis les a réduit a l’état de bractées squameuses, c’est d’ailleurs le cas pour Limodorum abortivum, alors que faut-il en penser?
ceci laisserait-il sous-entendre que le processus est réversible sur les exemples que vous citez ?
Cordialement,
JS.
Bonjour Jacques,
Chez les plantes achlorophylliennes, les feuilles ne « servent » en effet à rien ! Des expériences ont d’ailleurs montré que des albinos dont on avait manuellement enlevé les feuilles poussaient aussi bien – voire mieux – que des albinos avec feuilles. On l’explique notamment par une diminution de l’évaporation foliaire et donc du risque de sécheresse.
Cela explique pourquoi Neottia nidus-avis, Limodorum abortivum (qui est en grande partie mycohétérotrophe) mais aussi les holoparasites (orobanches, cuscutes…) les ont perdues au cours de l’évolution. Les plantes qui par hasard avaient des feuilles réduites avaient un avantage sur les plantes normales et le caractère « feuilles réduites » s’est donc répandu au sein de ces espèces.
Pourquoi alors n’est-ce pas le cas chez les mutants albinos ? Tout comme la perte de chlorophylle, les mutations qui peuvent conduire à la réduction foliaire sont très rares. La probabilité qu’apparaisse donc un individu à la fois albinos et à feuilles réduites est infinitésimale ! Pour avoir les deux il faut que la sélection puisse opérer sur une longue durée, or nos plantes albinos ne forment pas des populations à la fois stables et nombreuses qui le permettrait. Cela reste des cas isolés, a fortiori désavantagés par rapport aux individus verts classiques.
Autrement dit, tant que faire de la photosynthèse continue à procurer un avantage comme c’est le cas chez Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine ou Epipactis atrorubens, leurs feuilles n’auront pas tendance à se réduire et donc celles de albinos (qui n’en sont qu’une copie décolorée) non plus !
Merci Felix pour cette réponse claire et précise.
les orchidées représentent un domaine riche en études et leur évolution nous réserve bien des surprises.
Cordialement,
JS.
lepki jean-Pierre
Vraiment Passionnant ,votre article .. Ainsi j’en sais un peu plus .. pour le moment,il n’y en a Qu’un que j’ai trouvé .. c’est l’Orchis Singe .. Après ,c’est d’autre fleurs .. A Bientôt ..
Complétement passionnantes ces processus d’interaction entre les plantes et les champignons ! et l’article est tellement agréable à lire. C’est le genre d’écrit qui vous donne l’impression d’être intelligent, parce que l’on apprend avec plaisir.
Super article ! Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je suis tout à fait d’accord avec ce que Nicole Lallement vous écrit.
Le champignon récupérerait des vitamines et des enzymes produites par la noettie.
Bonjour et merci pour cet article éclairant (le blanc étant plus lumineux que le vert).
Question : les graines d’albinos sont-elles fertiles ? Si c’est le cas pourquoi ne voit-on pas de populations d’albinos (je n’ai jamais vu que des pieds albinos isolés)?
Bonjour Christian 🙂
Oui les graines d’albinos peuvent germer ! En revanche, elles y parviennent moins bien que les graines issues d’individus verts. Ce désavantage explique en partie pourquoi on ne voit pas de population entièrement constituée d’albinos, les verts sont plus compétitifs !
Par contre, on peut dans certains cas observer plusieurs albinos dans une même population. On pense qu’il existe des facteurs génétiques et environnementaux qui favorisent leur apparition et qui sont variables d’un site à l’autre.
Bonjour Félix,
Notre ami André m’a renvoyé vers cet article que j’avais déjà lu l’an passé mais que je n’avais pas revu depuis les commentaires de janvier 2017. A propos de « possibles » populations d’orchidées albinos, il n’est pas rare de trouver des touffes d’Epipactis purpurata de la forme rosea comme chez l’espèce nominale et les individus albinos n’apparaissent donc pas de façon isolée du moins chez cette espèce. mais on ne peut pas parler de vraie population puisque ces individus en touffe, issus d’un même rizhome, ne sont que des clones. Je me pose quand même une question : puisque l’albinisme semble être une mutation individuelle, peut-on imaginer un individu albinos d’Epipactis purpurata dans une touffe d’individus normaux ou bien la mutation génétique responsable de l’albinisme affectera-t-elle obligatoirement toutes les tiges de la touffe?
Au plaisir de te revoir
Amitiés
Henri
Bonjour Henri !
Je ne suis pas sûr de pouvoir apporter une réponse tranchée à ta question 🙂
D’abord, d’après les observations que j’ai pu faire, je n’ai jamais vu de tige albinos isolée parmi d’autres tiges vertes issues d’un même rhizome. Il semblerait donc que dans la majorité des cas l’albinisme résulte en effet d’une mutation touchant l’ensemble de la touffe.
En revanche, on peut observer certains cas où les plantes ne sont pas complètement albinos mais panachées, c’est à dire avec des taches vertes plus ou moins larges sur les feuilles. Ce genre de motif peut s’expliquer par des phénomènes dits d’épigénétique, c’est à dire non pas une mutation de la séquence d’ADN mais des modifications de la régulation de l’expression de certains gènes. De tels mécanismes peuvent être variables d’une cellule à l’autre mais peuvent toutefois se transmettre lors des divisions cellulaires donnant ainsi ces taches de cellules semblables.
Tout ça pour dire qu’on pourrait imaginer un cas d’épigénétique affectant une touffe qui porteraient donc des tiges de différentes couleurs ! Sans aller jusque là, une mutation ponctuelle qui toucherait un des méristème à l’origine d’une des tiges d’un rhizome pourrait aussi donner lieu à ce genre de cas hybride, peu probable mais pas impossible 😉
Amitiés